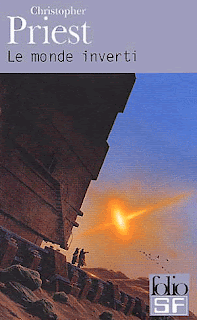Il n’est pas rare de nos jours d’entendre parler de la presse en des termes peu élogieux, des termes tels que désinformation et orientation de l’information sont des leitmotivs dans la bouche de ses détracteurs. Serge Halimi semble bien placé pour juger de l’état de la presse française, il a lui-même un pied dans la profession. Il est même devenu, et ce depuis Mars 2008, directeur du journal Le Monde. Il critique pourtant, avec Les Nouveaux chiens de garde, certains de ses collègues haut placés. Ce pamphlet a pour but d’initier le lecteur aux dérives ayant cours dans les milieux médiatiques, notamment dans les hautes sphères de notre presse nationale matérialisés par la trentaine de « barons » qui pèsent de leur influence sur toute la profession. Loin de décrier la profession, Serge Halimi s’attache à fournir, à l’aide de documents d’archives et par conséquent volatils, l’état catastrophique dans lequel est plongé le journalisme français. Si l’image des journalistes ressort ternie après lecture des Nouveaux chiens de garde, on est en droit de s’interroger sur le statut même de l’auteur, journaliste et qui pis est bénéficiant d’un poste relativement en vue. Pour ne pas discréditer Serge Halimi, car les faits semblent influer en sa faveur, il convient donc de narrer brièvement l’ « histoire » qui entoure ce pamphlet. Tout d’abord, Serge Halimi a tenu a ne pas faire de promotion pour son livre, il s’est contenté de laisser le bouche à oreilles faire le travail ; une décision qui a porté ses fruits semble-t-il, puisque Les Nouveaux chiens de garde fut un best-seller, avec 150.000 exemplaires écoulés. De plus, l’ouvrage fut très froidement accueilli et dépeint par ses confrères, ce qui m’incite encore plus à admettre dans les grandes lignes les affirmations de Serge Halimi, lequel cherche avant tout à montrer les écarts d’une profession qui, malgré son influence sur l’opinion, n’a de compte à rendre à personne. Et pour attester ses dires, il n’hésite pas à faire appel à des documents d’archives, car en matière d’information, le public comme les journalistes souffrent d’amnésie.
A travers ce pamphlet, Serge Halimi dénonce la collusion politique et médiatique ; une profession qui se proclame contre-pouvoir, « porte-parole des obscurs et des sans voix, forum de la démocratie ». Rien de mieux lorsqu’on se targue de la sorte de constater l’évolution effectuée depuis les années de l’ORTF, un détachement vis-à-vis du pouvoir étatique rendu possible grâce à la privatisation. Voici néanmoins un argument des plus faux, car s’il est vrai, sur le plan formel, que les journalistes ne sont plus soumis à l’Etat, la pratique infirme ce jugement. Lors d’une interview du Président de la République, par exemple, c’est l’Elysée qui tranche le choix du journaliste, en fonction du profil souhaité. Quant aux émissions politiques, où la parole est donnée au peuple, si elles ne plaisent pas aux gouvernants, ces derniers se permettront d’amputer le budget d’une chaîne publique d’une centaine de millions d’euros. Lors de la réforme des retraites en 1995, un tel programme avait déplu. Les journalistes à l’origine de l’idée avaient simplement répliqué que ce genre de défouloir jouait le rôle de soupape de sécurité, une décompression en quelque sorte. Quant au CSA, sacro saint garant de la neutralité des médias, on est en droit de s’interroger sur leur neutralité à eux. Les membres sont nommés par le Président de la République (UMP depuis 1995), le Président du Sénat (UMP depuis toujours), et par le Président de l’Assemblée Nationale (UMP depuis 2002). Et d’après Hervé Bourges, ancien président de l’institution, « Jamais le CSA ne pourrait se permettre de nommer quelqu’un qui serait à l’avance rejeté par l’actionnaire », en d’autres termes l’Etat.
Ce monde médiatique, où tout le monde est invité à tutoyer Sarko jusqu’à s’en montrer ouvertement fier, prodigue à ses amis politiciens de bien accommodants services, comme passer sous silence une situation ambigüe. Ainsi, lorsque Nicolas Sarkozy remplaça promptement Alain Carillon au poste de ministre de tutelle des télévisions et radios publiques, il se trouvait déjà ministre du Budget et … porte-parole d’Edouard Balladur, candidat à la Présidence de la république. Citons également le cas Mitterrand, dans lequel la presse française s’est brillamment illustrée en ne dévoilant aucune information sur le cancer de l’intéressé. Ou bien alors, quand il arrive à certains journalistes de faire preuve d’audace, ils prennent des gants bien molletonnés pour parler de questions polémiques. D’autre part, si les hommes politiques se lient d’amitié avec les pontes médiatiques, c’est aussi par soucis d’éducation. Ils permettent à ces derniers de s’intégrer à des comités de réflexion et d’y découvrir les problèmes et solutions envisagées ; les journalistes pourront d’autant mieux jouer un rôle pédagogique au moment de passer à l’antenne. Mais cette collaboration remet en cause leur indépendance vis-à-vis du missionnaire et des personnalités côtoyées. Cette collusion des pouvoirs médiatiques et politiques sera évidemment susceptible d’orienter un journal, télévisé ou écrit. Le journalisme actuel est creux et révérencieux, il est mercantile et certainement pas de nature politique. Les services sont réciproques, car pendant qu’un journaliste se voit décoré par un ministre d’un de ces colifichets à la signification perdue dans les limbes de l’Histoire, les anciens ministres, eux, trouvent refuge au sein des groupes de presse.
Cependant, tandis que médias et politiciens forniquent de conserve (Jean-Louis Borloo et Béatrice Schoenberg par exemple), les premiers sont asservis par les industriels. Serge Halimi paraphrase ici Noam Chomsky : « l’analyse du dévoiement médiatique n’exige, dans les pays occidentaux, aucun recours à la théorie du complot. » Et de suite après de citer la réponse de Chomsky à un étudiant, curieux de connaître la manière dont l’élite contrôle les médias : « Comment contrôle-t-elle les General Motors ? La question ne se pose pas. L’élite n’a pas à contrôler General Motors, elle lui appartient. » En effet, les capitaux des organes de presse sont détenus en grande majorité par des groupes comme LVMH, Bouygues, Vivendi, Matra-Hachette, Lagardère, Dassault, Bolloré, reproduisant ainsi la situation du Comité des Forges lors de l’entre-deux-guerres. Serge Halimi nous renvoie alors au discours de Daladier le 28 Octobre 1934 devant le congrès du parti : « Deux cent familles sont maîtresses de l’économie française, et, en fait, de la politique française. Ce sont des forces qu’un état démocratique ne devrait pas tolérer, que Richelieu n’eut pas toléré dans le royaume de France. L’influence des deux cents familles pèse sur le système fiscal, sur les transports, sur le crédit. Les deux cents familles placent au pouvoir leurs délégués. Elles interviennent sur l’opinion publique, car elles contrôlent la presse. »
Rien d’étonnant donc à lire Serge Halimi qualifier la profession de « journalisme de marché. » Néanmoins, la désinformation, reconnait-il, n’est pas toujours issue de la volonté de manipulation ; elle procède parfois de l’incompétence du journaliste. Ceux-ci se retrouvent parfois pris au piège des structures mentales qu’ils ont contribué à édifier, comme lors d’un « débat » sur les attentats, où l’assimilation implicite entre musulmans et islamistes se produisit par le biais de la « fracture entre français et musulmans. » Le traitement de l’information internationale est également remis en cause ; les faits relatés iraient parfois à contresens de la réalité, tout en demeurant couplé à une écriture automatique, intellectuellement peu exigeante en raison du temps requis. Volontairement bâclée, l’actualité internationale se voit reléguée au second plan au nom de l’audimat. Car de plus en plus, et peut-être l’avez-vous remarqué, « le fait divers fait diversion », certains thèmes racoleurs se multiplient d’autant plus que leur coût de fabrication est dérisoire, en dépit du fait que la surabondance de ces sujets ne reflète pas la réalité. Les responsables de rédaction se copient les uns les autres et tendent donc vers l’uniformité, étouffant par là même le pluralisme que revendiquent nos médias : « le journalisme de marché domine à ce point les médias français qu’il est très facile – pour le lecteur, pour l’auditeur, pour le journaliste – de passer d’un titre, d’une station ou d’une chaîne à l’autre. Au niveau de la presse hebdomadaire, cette ressemblance assomme : les couvertures, suppléments et articles sont devenus interchangeables ; ce sont souvent les conditions d’abonnement – pour parler clair, la valeur des produits ménagers convoyés avec le journal – qui déterminent le choix du client. »
Cette uniformité, d’après Serge Halimi, serait le reflet de la pensée unique, instituée par les « maîtres du monde », qui la partagent tous dans son entièreté. La pensée unique n’est pas neutre ni changeante, « elle traduit en termes idéologiques à prétention universelle les intérêts du capital international, de ceux qu’on appelle les marchés, les gros brasseurs de fonds. » En abusant du crédit et de la réputation qu’on leur attribue, les institutions économiques internationales (Banque Mondiale, FMI, OCDE, Banque Centrale Européenne) souhaitent soumettre les élus à ses « Tables de la Loi », à « la seule politique possible, incontournable », puisqu’elle possède l’aval des riches. Toujours d’après l’auteur, l’idéal de la pensée unique est de dépouiller le débat démocratique de sens, le réduire à un périmètre idéologique minuscule « puisqu’il n’arbitrerait plus entre les deux termes d’une alternative. »
Je me permets ici une critique sur la forme, car si Serge Halimi critique le libéralisme – ou le capitalisme -, avec véhémence parfois, il n’avance pas pour autant de preuve étayant tous ses dires. Pour les obtenir, je pense donc m’orienter vers La Fabrication de l’opinion, de Noam Chomsky et Edward Herman. Fin de l’aparté, je reviens sur le propos du livre et sur la pensée unique, à propos de laquelle l’auteur nous met en garde : « Céder à cette pensée là, c’est accepter que la rentabilité prenne partout le pas sur l’utilité sociale, c’est encourager le mépris du politique et le nique du capital » ; et la presse célèbre le libéralisme comme une avancée, une certitude économique, ou le critique sur des aspects passés. C’est sur LCI notamment que l’amour de l’argent se manifeste au grand jour, que Jean-Marc Sylvestre partage sa foi : « Il n’y a pas de progrès social sans progrès politique. » On sent donc un conditionnement des médias en faveur du capitalisme, les journalistes reprennent en substance les propos des chefs d’entreprise. Certains professionnels osent même se fabriquer une auréole de prestige en se prétendant dissident vis-à-vis de l’ordre établi.
Les journalistes éludent donc les vraies questions, mais ce avec la coopération des hommes politiques, qui consentent à ce simulacre et acceptent de réserver leurs affrontements aux questions accessoires. D’autant plus que les journalistes ne jettent plus de regard critique sur le monde ; dans leur logique d’accompagnement de la classe dirigeante, leur rôle se résume à expliquer l’économie-monde, rôle d’autant plus crucial qu’on se reproche d’avoir du retard en la matière.
Serge Halimi nous décrit également ce monde médiatique comme un « univers de connivence », où les services réciproques pullulent jusqu’à frôler l’absurdité. Ne serait-ce qu’à travers les articles louangeurs sur le livre d’un collègue ou ami, ces retours d’ascenseur permanents dont n’hésitent pas à user les journalistes, jusqu’à vanter hypocritement l’ouvrage d’un collègue de rédaction à force de superlatifs portés aux nues. Ou encore à truquer chaque année le concours récompensant le « meilleur ouvrage » d’un confrère. Mais le comble reste les cas d’auteurs reconnus juridiquement de plagiat qui continuent d’être encensés par leurs copains journalistes ; citons le cas Alain Minc au hasard. Cette connivence se manifeste de manière peut-être visible par le ballet incessant des journalistes, trimballés de chaîne en chaîne, de station en station, ou de quotidien en quotidien. Certains même cumulent les postes, ce que les médias, toujours prompts à dénoncer cette pratique chez les hommes politiques, ne semblent pas remarquer lorsqu’il s’agit de leur paroisse. Pour terminer, Serge Halimi remet en question le statut même des « commentateurs vedettes », ces superstars de l’info qu’il est impossible de manquer quand on est un minimum relié au monde. Est-ce tellement grâce à leur travail et à leur savoir-faire que ces gens là bénéficient de cette notoriété, ou bien en raison de leur fréquence d’apparition ? La réponse est, bien évidemment, dans la question.
Beaucoup a été dit sur Les Nouveaux chiens de garde, au point que ce billet ressemble, à juste titre, à un résumé de ce court pamphlet. Après avoir rapporté, fidèlement je l’espère, les propos de l’auteur, je m’autorise maintenant une note personnelle. Si j’avais une vague conscience d’être manipulé par les médias, je ne pensais pas, ignorant que je suis, que la pratique s’étendait si profondément sur tous les supports. Néanmoins, si le constat peut paraître effrayant, Serge Halimi tempère ses propos, il nous montre que malgré l’obstination de la presse à nous malaxer le cerveau, l’opinion publique n’est pas toujours à la merci de journalistes peu scrupuleux.